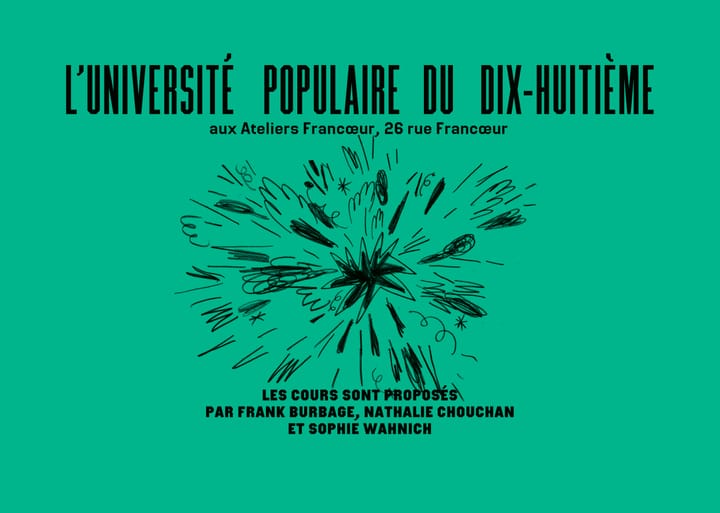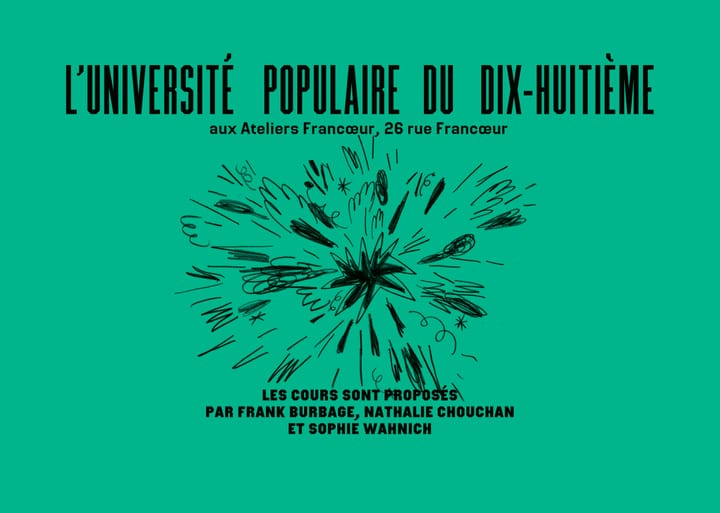Frank Burbage - Walter Benjamin Expérience et pauvreté
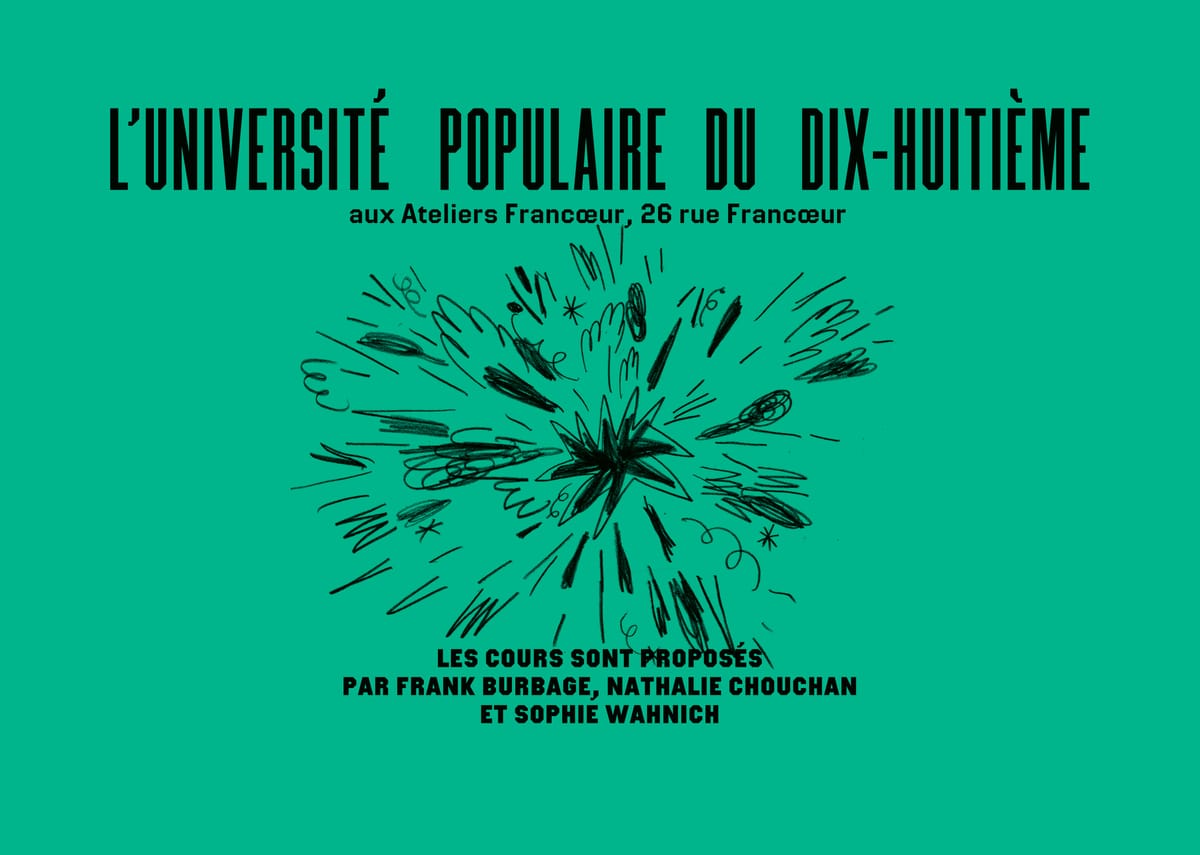
Le texte de Walter Benjamin - Expérience et pauvreté
Le 7 décembre 1933, Benjamin publiait dans la revue Die Welt im Wort un article intitulé « Expérience et pauvreté » .
Pour lire ce texte il importe bien sûr de se rendre attentif au contexte : 1933 est une « année terrible » , une charnière dans l’avènement de ce qu’Hannah Arendt nomme à la suite de Brecht de « sombres temps » . Benjamin ne s’y trompe pas : « à la porte, dit-il, se tient la crise économique, derrière elle une ombre, la guerre qui s’approche » ; l’ombre dans l’ombre est portée par la montée en puissance des fascismes européens, qui se nourrissent de cette crise, et l’inscrivent parfois dans une mystique de la mort universelle, réputée salvatrice. A ce sujet Benjamin évoque la figure inquiétante de Méduse . Mais son propos se veut plus englobant, plus compréhensif : qu’est-il arrivé pour que tout cela se tienne « à la porte » ? ou pour qu’il soit si difficile de s’en déprendre ? La réponse tient en un mot : « pauvres, voilà bien ce que nous sommes devenus » . Qu’est-ce que cette « pauvreté » ? Benjamin la conçoit comme un rétrécissement du monde, à partir du moment où l’expérience – celle qui passe d’une génération à l’autre – cesse d’être disponible. La pauvreté, c’est la pauvreté « en expérience » , la tradition interrompue, la transmission empêchée : « où tout cela est-il passé ? Trouve-t-on encore des gens capables de raconter une histoire ? Où les mourants prononcent-ils encore des paroles impérissables, qui se transmettent de génération en génération ? (…) Qui chercherait à clouer le bec à la jeunesse en invoquant son expérience passée ? » Loin d’être le fait d’on ne sait quelle paresse, ou négligence, progressivement ou subitement survenue, cette rupture de continuité provient de la guerre. Ou plutôt d’une guerre, la guerre 14-18, dont l’effroyable nouveauté aura été telle qu’on ne pouvait que « revenir muet du champ de bataille » . Ce mutisme signale un anéantissement de l’expérience, dont la continuité se brise en amont comme en aval : « jamais expériences acquises n’ont été aussi radicalement démenties que l’expérience stratégique par la guerre de position, l’expérience économique par l’inflation, l’expérience corporelle par l’épreuve de la faim, l’expérience morale par les manœuvres des gouvernants. » Que dire alors et comment ? Comment raconter, transmettre ? Ceux qui ont survécu, dit Benjamin, sont devenus non pas plus riches, mais « plus pauvres en expérience communicable » . Dans le même temps, les leçons héritées du passé ont soudainement perdu leur signification, et l’humanité survivante s’est trouve acculée non seulement à la possibilité, mais à la nécessité d’une « nouvelle espèce de barbarie » . Non celle de ceux qui se trouveraient – à supposer que cela soit concevable - en deçà de la civilisation ; mais celle qui atteint ceux qui sont projetés dans une sorte de nouveau début : « à quoi sa pauvreté en expérience amène-t-elle le barbare ? Elle l’amène à recommencer au début, à reprendre à zéro, à se débrouiller avec peu , à construire avec presque rien , sans tourner la tête de droite ni de gauche » . Le paradoxe de cette « barbarie » , c’est qu’elle offre à la création un espace sans bornes : « parmi les grands créateurs, il y a toujours eu de ces esprits impitoyables, qui aspiraient par faire table rase » . Benjamin désigne Klee, Loos, Brecht, Scheebart, comme autant de témoins mais aussi d’acteurs de cette situation nouvelle. Plus ou moins explicitement, ils repoussent l’image d’un homme « paré de toutes les offrandes sacrificatoires du passé » , pour se tourner vers leur contemporain, qui, « dépouillé de ses oripeaux, crie comme un nouveau né dans les langes sales de cette époque. » Brecht conçoit le communisme comme distribution non de la richesse, mais de la pauvreté. Loos ou Le Corbusier cherchent des matériaux – le verre, le fer, le béton – épurés, et dégagés du fatras d’une tradition devenue dérisoire, « ennemis du mystère » , sur lesquels se perd la possibilité même d’une trace. Que seront ces maisons, ou ces villes, dans laquelle les habitants ne laisseront par de traces ? Klee, comme les cubistes, adossent ses figures à la structure géométrique : « c’est, dit Benjamin, ce qui les rend barbares » . Les modèles mathématiques ou techniques – la manière des ingénieurs - prennent le pas sur des modèles organiques devenus caducs, trop impliqués dans la continuité et dans la transmission. Au delà des souffrances et des traumatismes de la guerre, on peut sans doute se réjouir d’un tel monde – y adhérer joyeusement et activement, dans un mariage habile de discernement et de renoncement Mais cette jubilation est amère, qui marque la subversion du principe fondateur de tout humanisme : une ressemblance de l’homme avec l’homme. On pourra bientôt, dit Benjamin qui pense alors aux pratiques de la nouvelle URSS, donner aux enfants des noms « déshumanisés » : « Aviakhim » , par exemple, d’après le nom d’une compagnie d’aviation.
Cette « pauvreté en expérience » ne signifie pas « que les hommes aspirent à une expérience nouvelle » . Plutôt cherchent-ils « à se libérer de toute expérience quelle qu’elle soit » : « ils aspirent à un environnement dans lequel ils puissent faire valoir leur pauvreté, extérieure et finalement aussi intérieure, à l’affirmer si clairement et si nettement qu’il en sorte quelque chose de valable » . Que l’existence puisse « en toute circonstance [se suffire] à elle-même de la façon la plus simple et en même temps la plus confortable » , voilà une perspective qui ne manque pas d’attrait, et qui permettrait sans doute de « survivre, s’il le faut, à la civilisation » . Reste à prendre la mesure de ce qu’elle coûte : « pièce à pièce, nous avons dispersé le trésor de l’humanité, nous avons dû laisser ce trésor au mont de piété, souvent pour un centième de sa valeur, en échange de la piécette de l’ « actuel » . A la porte se tient la crise économique, derrière elle une ombre, la guerre qui s’apprête… » . Nous voici revenus à notre point de départ.
Sans doute de tels propos s’offrent-ils, du point de vue que nous occupons aujourd’hui, à une possible relativisation. Pris dans la tourmente d’événements écrasants, on peut considérer que Benjamin sous-estime la puissance de continuité – reconstitution quasi organique peut-être, sociale en tout cas – de la civilisation humaine. Plus précisément : sa capacité de joindre à nouveau, sous des formes inédites, les fils brisés de la mémoire, pour rétablir la longue durée d’une expérience communicable. Benjamin conçoit avec une très grande acuité l’acosmie de l’entre-deux guerres. Mais il transforme cet ébranlement profond du monde – de sa publicité - en une faillite définitive, au lieu de la circonscrire comme un moment, dans une histoire qui contient effectivement la « barbarie », mais qui ne s’y réduit pas. Hannah Arendt insiste sur ce point : un long temps est requis (trente ans au moins si l’on pense à la réponse qu’avec Parabole Faulkner offre au premier conflit mondial) pour que de tels événements puissent être parlés, représentés, et partiellement assumés dans le cadre d’un pâtir dont la tragédie antique constitue le modèle. Rien d’étonnant qu’en 1933 – à mi-parcours donc – le clivage reste si vif entre un passé trop proche pour être simplement dit, a fortiori partagé, et une vitalité ingénieuse, cherchant à renaître dans un oubli apparent des temps anciens. « Après la Première Guerre mondiale, nous avons vécu la « maîtrise du passé » en débordement de descriptions de la guerre d’une grande variété de genre et de qualité ; cela, bien sûr, n’eût pas lieu en Allemagne, mais dans tous les pays touchés. Pourtant, il fallut que trente ans, environ, passent, avant que n’apparaisse une œuvre d’art déployant avec une telle transparence la vérité interne de l’événement qu’il devint possible de dire : Oui, c’est bien ainsi que cela fût. » Benjamin au contraire croît à la barbarie définitive de ceux (on pense à Brecht notamment) qui travaillent à faire revivre quelque chose de l’antique catharsis. Or c’est elle justement qui retourne cette perte du monde liée au délitement de l’espace public : loin de reconduire sans cesse à une irrémédiable pauvreté, elle offre en partage quelques moyens de ne pas s’y laisser engloutir.
Mais là n’est pas l’essentiel. Il se trouve plutôt dans le déplacement même que Benjamin opère ici : la pauvreté est écartée d’une détermination strictement économique (celle qui serait immédiatement rapportée à la « crise économique » , si proche, et à la violence qui s’y déploie) ; elle caractérise le trait caractéristique d’une existence toute entière vouée au présent, et contrainte d’ « habiter sans laisser de traces » . Ainsi ce n’est pas vers une humaine et ancestrale condition que l’on se tourne, mais vers le moment contemporain de l’histoire universelle : c’est là (là seulement ?) que la pauvreté vient coïncider, sinon avec la fin du monde, au moins avec un certain empêchement du monde. Mais jamais cet écart par rapport à l’économique et au politique n’a pas le sens d’une rupture entre des temps, des espaces ou des ordres : parce que la crise économique se tient « à la porte » ; parce que la guerre est « derrière elle » ; parce que notre « pauvreté en expérience n’est qu’un aspect de cette grande pauvreté qui a de nouveau trouvé un visage – un visage aussi net que celui du mendiant du Moyen-Âge » .
On dira que tout cela n’est pas très clair. D’un côté, cette « pauvreté en expérience » participe d’une nouveauté qu’on dit radicale. D’un autre côté, elle reconduit comme un « nouvel aspect » à une « grande pauvreté » sinon persistante, du moins déjà existante. Sans que l’on sache très bien comment cette « grande pauvreté » doit être comprise, et si elle est autre chose qu’un trait de condition, l’un des multiples noms de la finitude.
Comment s’articulent les déterminations « économiques » ou « sociologiques » et celles qui ne le sont pas ? Cette distinction a-t-elle simplement un sens, et une justification ?
Comment s’articulent les différents visages ou figures de la pauvreté ? Ont-ils même quelque rapport ? Prennent-ils place au sein d’une histoire unifiée ?